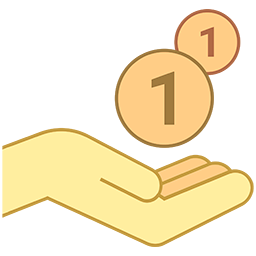Soutenez lauteur !
Espérer lEurope, cest espérer en vain pendant cent ans. Comment lUE cherche sa place dans un monde nouveau

Il est évident que la principale orientation stratégique de l'UE (en alliance avec le Royaume-Uni) doit aujourd'hui viser avant tout à acquérir une autonomie en matière de sécurité. Cela implique la production d'armes, la formation d'armées opérationnelles, ainsi que la création de nouveaux centres de commandement, dans le cadre de l'OTAN ou parallèlement, tout en maintenant simultanément la stabilité politique et économique en Europe. L'ensemble constitue une tâche complexe, car les citoyens européens souhaitent continuer à vivre paisiblement, bénéficiant de nombreuses garanties sociales et sans renoncer à leur mode de vie habituel.

Parmi les principaux événements politiques du dernier mois, on peut citer deux sommets, le G7 et l'OTAN, ainsi que l'attaque rapide et efficace d'Israël contre le programme nucléaire iranien, à laquelle les États-Unis se sont joints au moment opportun pour porter un coup décisif. Le degré des dégâts fait l'objet de débats, certains experts estimant que l'Iran pourrait reprendre ses travaux sur son projet nucléaire prochainement. Néanmoins, la puissance militaire démontrée par Israël et les États-Unis a fait forte impression.
Dans ce contexte, les dirigeants européens ont paru peu convaincants. Le sommet du G7 au Canada s'est déroulé dans une ambiance nerveuse et confuse, Donald Trump l'ayant quitté prématurément pour des affaires plus importantes. Cherchant à éviter un scénario similaire lors du sommet de l'OTAN à La Haye, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte a adressé plusieurs messages élogieux au président américain, louant sa détermination et sa sagesse. Ces efforts ont peut-être porté leurs fruits et influencé la bonne humeur de Trump lors de son séjour à La Haye, mais la presse européenne n'a pas ménagé ses critiques à l'encontre de ses dirigeants politiques, qui ont accepté des rôles secondaires douteux dans le spectacle principal dominé par la star venue de Washington.
Si ces malentendus ne concernaient que des erreurs protocolaires ou des maladresses d'expression, ils ne mériteraient pas tant d'attention. Le problème est ailleurs :
on aurait pu croire que les Européens se replongeaient une fois de plus dans leurs divisions internes, et les signes de désaccords étaient plus inquiétants que quelques propos étranges isolés.
Par exemple, Emmanuel Macron appelait constamment à un cessez-le-feu au Moyen-Orient et associait notamment le départ soudain du président américain du sommet du G7 à la préparation de négociations, ce qui lui valut une raillerie de Donald Trump le qualifiant de confus qui « se trompe toujours ». En revanche, le chancelier allemand Friedrich Merz saluait les frappes d'Israël contre l'Iran, les qualifiant de « travail sale » accompli « pour nous tous ». Au sommet de l'OTAN, tous les participants se sont félicités de leur intention d'augmenter les dépenses de défense à 5 % (dont 1,5 % pour les infrastructures), mais le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a jugé cette dépense excessive impossible, provoquant immédiatement la colère et les menaces de Trump à son encontre.
Toutes ces circonstances ont de nouveau ravivé les débats sur un « déclin de l'Europe », incapable de transformer son potentiel économique, humain et historique en puissance politique, et donc condamnée à perdre face à des acteurs plus déterminés et résolus dans un monde en mutation. Ce point de vue est bien connu, mais peut-être néglige-t-il certains facteurs importants.
Guerre commerciale
Les impressions des sommets du G7 et de l'OTAN ont effectivement été défavorables aux Européens. Le premier peut être considéré comme un échec, voire un fiasco, Trump montrant ouvertement son manque d'intérêt pour l'agenda et son mépris habituel envers ses alliés, se traduisant par son départ anticipé. C'est pourquoi le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte a tout fait pour éviter un tel scénario à La Haye.

La connaissance aiguë du tempérament particulier du président américain permettait de s'attendre à toutes sortes de déclarations, selon son humeur, y compris un refus de l'article 5 du traité et une révision du rôle des États-Unis dans l'Alliance. Pourtant, alors que la guerre se poursuit en Ukraine, que les risques d'escalade militaire avec la Russie persistent en Europe, et que les pays européens lancent des programmes de réarmement et de renforcement de leurs armées, un scandale à l'OTAN serait extrêmement indésirable. Non seulement en termes d'image ou de mauvaise inspiration pour le Kremlin, mais surtout en raison de la nécessité de réorganiser l'Alliance en urgence et sur le vif. L'OTAN dépend trop des Américains, même à un niveau purement technique et organisationnel.
D'autre part, il était très important pour les Européens de rappeler à Trump la problématique de la guerre en Ukraine, ce qui pouvait être accompli lors d'une rencontre personnelle entre présidents. Au Canada, lors du sommet du G7, cela n'a pas eu lieu ; à La Haye, la venue de Zelensky et son bref échange avec Trump ont pu être considérés comme un succès tactique relatif.

Quoi qu'il en soit, le communiqué final contient un engagement des parties envers l'article 5 du traité de l'OTAN(8), et le comportement du président américain, à l'exception de ses attaques contre l'Espagne rebelle, semblait assez pacifique. Mais quelques jours plus tard, Washington annonçait la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, confirmant une fois de plus l'inutilité des efforts pour parvenir à des accords solides avec l'administration américaine actuelle.
Cependant, en dehors des deux sommets, il existait une question bien plus importante que les sourires protocolaires des dirigeants politiques : les négociations d'un nouvel accord commercial entre l'UE et les États-Unis.
Comme on le sait, le président Trump est un fervent partisan de l'imposition de droits de douane élevés sur les produits importés aux États-Unis. Il considère le déficit commercial comme un vol en plein jour et ne fait pas de distinction entre alliés et pays moins amicaux. Il n'est donc pas surprenant qu'en quelques mois seulement, il ait annoncé l'imposition de droits de douane sur les produits européens, puis en ait annulé certains, avant de geler la plupart d'entre eux jusqu'au 9 juillet, date prévue de la conclusion des négociations sur un nouvel accord commercial. Ce délai approche, mais il est connu que les divergences entre les parties sont très importantes.
La situation est compliquée par le fait que seuls l'UE et la Chine, dans le monde actuel, disposent d'économies comparables à celle des États-Unis et pourraient, si elles le souhaitaient, engager une escalade tarifaire avec Washington, mais préfèrent négocier avec Trump tant que cela est possible pour éviter les pires scénarios.
Il est évident que personne dans l'UE ne souhaite une guerre commerciale avec les États-Unis, mais Bruxelles comprend bien à la fois les avantages de sa position, notamment un marché unique de 450 millions de consommateurs solvables, et ses faiblesses.
Le problème de la position de négociation de l'UE réside dans le fait que les intérêts des différents pays européens sur le marché américain ne coïncident pas.
Par exemple, l'Allemagne exporte ses voitures aux États-Unis, tandis que la France exporte du cognac et du champagne, et si Washington imposait de hauts droits sur un groupe de produits tout en privilégiant un autre, cela pourrait provoquer une fracture au sein des rangs européens. L'UE est une puissance économique forte uniquement grâce à son unité, ce que les capitales européennes comprennent bien. C'est pourquoi il ne faut pas accorder trop d'importance aux images des sommets, qui ne signifient ni un accord des Européens avec la domination américaine, ni un renoncement à la défense de leurs propres intérêts. Il s'agit simplement d'une manœuvre tactique, dont la pertinence peut bien sûr être discutée.
L'Iran et l'Ukraine
Une certaine passivité de l'Europe dans les affaires du Moyen-Orient, ainsi que la cacophonie des dirigeants européens concernant les actions d'Israël, peuvent être interprétées comme un « retrait de l'histoire », une concession des positions anciennes à de nouveaux prétendants plus jeunes et plus agressifs. Cependant, une autre lecture pragmatique est possible : l'Europe comprend que « ce n'est pas sa guerre ». Tous s'accordent sur le fait que l'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires, qu'il doit respecter le traité de non-prolifération et coopérer avec l'AIEA. En dehors de cela, certains, comme Macron, appellent à la négociation et craignent les conséquences d'une escalade, tandis que d'autres, comme Merz, félicitent Israël pour son travail bien fait — ce qui n'a d'importance qu'en tant que position locale de certains pays dans leurs relations bilatérales avec Israël, le monde arabe ou l'Iran.
Mais la situation est tout autre pour l'Ukraine. De nombreux facteurs expliquent une attitude différente face à cette guerre qui se déroule en Europe, à proximité immédiate des frontières de l'UE. L'agresseur est la Russie, perçue historiquement en Europe de l'Est comme une menace directe, et ces craintes sont fondées. Du budget global de l'UE(10), ainsi que des budgets nationaux, des centaines de milliards d'euros ont déjà été alloués au soutien de l'Ukraine et à l'aide aux réfugiés. Les États-Unis cherchent à se distancier des problèmes du Vieux Continent en général et de l'aide à Kiev en particulier, en renvoyant ces responsabilités aux Européens, ce qui ne suscite pas de contestation de fond, mais oblige à réorienter rapidement l'économie européenne vers une logique plus militaire.
La défaite de l'Ukraine signifierait pour l'Europe non seulement la présence à ses frontières d'une armée bien armée, forte d'une expérience de combat récente et d'un goût de la victoire, mais aussi la nécessité urgente de construire un nouveau système de sécurité, en tenant compte à la fois de la menace russe et de la fiabilité douteuse des alliés américains.
Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les Européens n'aient pas souhaité s'impliquer dans le conflit iranien, préférant concentrer leurs efforts sur un épineux dossier de négociations avec les États-Unis et poursuivre leur soutien à l'Ukraine malgré l'incertitude de la position américaine.
On peut aussi noter une conversation téléphonique inattendue entre les présidents Macron et Poutine, qui ne s'étaient pas parlé depuis près de trois ans. Selon les rapports officiels succincts, les deux parties ont discuté de l'Iran et de l'Ukraine, mais n'ont fait que répéter leurs positions déjà connues. Dans ce cas, il est difficile de comprendre pourquoi l'entretien a duré deux heures, et plus encore, pourquoi le président russe, qui parle si souvent des Européens sur un ton condescendant, leur refusant toute subjectivité comparée aux États-Unis, a décroché le téléphone.

En réalité, beaucoup dépend de la position européenne, sans laquelle Trump ne conclura aucun accord avec Poutine sur l'Ukraine, ce que la partie russe comprend bien. Il faudra parler avec Macron ou Merz ; peut-être que de nouvelles conditions sont apparues à cet égard.
Stratégie et tactique
Il est évident que la principale orientation stratégique de l'UE (en alliance avec le Royaume-Uni) doit aujourd'hui viser avant tout à acquérir une autonomie en matière de sécurité. Cela implique la production d'armes, la formation d'armées opérationnelles, ainsi que la création de nouveaux centres de commandement, dans le cadre de l'OTAN ou parallèlement, tout en maintenant simultanément la stabilité politique et économique en Europe. Tout cela constitue une tâche complexe, car les citoyens européens souhaitent continuer à vivre paisiblement, bénéficiant de nombreuses garanties sociales et sans renoncer à leur mode de vie habituel.
On peut supposer qu'en tactique, les Européens ont choisi de s'engager dans une atténuation constante des tensions avec les États-Unis afin de gagner du temps.
Dans cette optique, il faut faire des concessions et accepter des pertes d'image, mais l'histoire pourrait bien confirmer la justesse de cette approche. D'autant plus que la position de l'Europe en tant que dernier bastion des valeurs du droit international n'est pas aussi dépassée qu'on pourrait le croire, même pour les partisans des méthodes de force. Dans le monde actuel, tous ne partagent pas les méthodes de Trump ou de Poutine. Par exemple, dans les pays du Sud global, personne ne s'attaque mutuellement en Amérique du Sud, et le principal problème reconnu est le développement. Il en va de même pour de nombreux pays d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est — chacun a bien sûr ses préoccupations, mais le marché de l'UE est attractif pour tous, tout comme le respect des règles dans la défense des intérêts nationaux. À long terme, le ton posé des Européens et leur fidélité aux principes du droit international (si ces qualités sont préservées) pourraient leur valoir une large reconnaissance.

Cependant, toutes ces danses des dirigeants européens autour de Trump, quelles que soient leurs justifications tactiques, inquiètent pour deux raisons. Premièrement, à un moment donné, la succession de manœuvres habiles doit céder la place à une position ferme et de principe — sinon l'habitude du contournement ne fera que renforcer l'art de l'intrigue, sans rapprocher des objectifs stratégiques. Deuxièmement, il ne faut pas oublier les électeurs européens, qui ne veulent pas s'attarder sur les subtilités des relations avec le président américain, mais espèrent la compétence de leurs propres politiciens. Lorsque l'on évoque la montée des populismes en Europe, l'une des principales causes est considérée comme l'incapacité de la classe politique européenne à prendre des décisions difficiles, son penchant pour les compromis et les hésitations, son engouement pour les tactiques au détriment de la fermeté stratégique. Les électeurs déçus peuvent alors appeler de nouvelles forces au pouvoir, qui à leur tour remettront en cause les programmes européens actuels en matière de sécurité. Dans ce cas, les louanges astucieuses de Mark Rutte à l'adresse de Donald Trump resteront dans l'histoire comme un exemple d'efforts vains et sans gloire, qui auraient pu être mieux employés.
Sur la photo principale — Donald Trump discute avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte lors du sommet à La Haye, 25 juin 2025. Source : Ministerie van Buitenlandse Zaken / Bart Maat / CC BY-SA 4.0