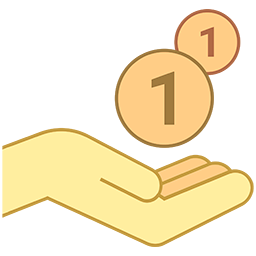Soutenez lauteur !
La non-liberté sans égalité ni fraternité. Pourquoi la France a-t-elle décidé de collaborer avec Hitler il y a 85 ans ?

On a conclu à Paris un pacte faustien avec le diable dans l'espoir de sauver au moins quelque chose de leur pays. Pourtant, la « politique de paix » nazie visait précisément à absorber complètement les vaincus.

La participation de la France à la Seconde Guerre mondiale laisse un arrière-goût étrange, qui se fait périodiquement sentir encore aujourd’hui. Juridiquement, ce pays est l’une des puissances victorieuses, ayant combattu le nazisme et reçu la capitulation des nazis en mai 1945. Pourtant, des années plus tard, la capacité de combat de l’armée française des années 1940 est une source de moqueries à l’étranger, dans les apocryphes pseudo-historiques ce sont précisément les Français qui apparaissent comme des « vainqueurs pas vraiment réels », et les politiciens locaux, même au XXIe siècle, sont contraints de se repentir de la complicité de leur peuple dans l’Holocauste.
Tout cela est l’écho prolongé du régime de Vichy, l’une des pages les plus désagréables de l’histoire nationale. D’une part, il ne doit pas faire oublier l’exploit de milliers de Français qui ont courageusement combattu le Troisième Reich. Qu’ils aient été dans les maquis chez eux, dans les colonies africaines ou au-dessus de l’Europe de l’Est au sein du légendaire régiment « Normandie-Niemen ».
D’autre part, on ne peut pas ignorer la réalité : entre 1940 et 1944, en métropole, il existait de facto un régime ami de l’Allemagne. Il collaborait activement avec les nazis sur le plan économique, aidait ses partenaires à exterminer les Juifs et tentait même de participer à la « croisade contre le bolchevisme ». Comment se fait-il que la patrie des droits de l’homme et la citadelle des valeurs républicaines ait essayé de cohabiter avec l’une des dictatures les plus laides et inhumaines de l’histoire mondiale ?
Mais qui juge ?
À l’automne 1944, la France libérée se dépêchait de se débarrasser de toutes les teintes marron. La guerre continuait, mais les concitoyens accusés de collaboration étaient déjà attendus devant des tribunaux spéciaux. Le 19 janvier 1945, l’un de ces tribunaux examinait le cas de Robert Brasillach.
Il n’était pas nécessaire d’expliquer aux contemporains qui était ce journaliste et écrivain de 35 ans ni pourquoi il était jugé. Avant la guerre, Brasillach s’était fait une réputation retentissante et controversée en diffusant une ligne très à droite. Originaire du Sud de l’Occitanie, il appelait tantôt à achever la démocratie française des années 1930 à bout de souffle, tantôt à résoudre définitivement la « question juive » dans le pays.

L’apparence de Robert ne correspondait pas du tout à son discours haineux. Il jouait le rôle d’un ultranationaliste brutal, mais c’était un petit homme frêle au visage enfantin, portant des lunettes à monture épaisse. De plus, tout le monde savait que Brasillach était homosexuel. Pourtant, l’écrivain ne voyait aucune contradiction en lui, ne changeait pas d’opinions, et à l’été 1940, il considérait la défaite militaire de son pays comme une chance pour sa renaissance. « Il me semble que j’ai noué un lien avec le génie allemand que je n’oublierai jamais. Qu’on le veuille ou non, nous allons vivre ensemble. »
Le journal de Brasillach, Je suis partout (« Je suis partout ») est devenu pour beaucoup de Français la carte de visite de l’occupation et du régime de Vichy. Là, le collaborateur se réjouissait de la fin de la Troisième République (la « vieille prostituée syphilitique »), appelait à écraser la Résistance et chantait les rafles antijuives avec les déportations qui s’ensuivaient vers le Reich. Oui, en France entre 1940 et 1944, beaucoup faisaient le salut nazi, mais pas avec autant de sincérité, d’enthousiasme et de créativité que Brasillach, même les hauts fonctionnaires vichystes n’étaient pas à ce niveau.
« Les rats, menacés d’extinction, juraient qu’ils étaient en réalité des chats, des chats exotiques de Siam et de Perse, et qu’on ne pouvait donc pas les reconnaître. Ils montraient même des papiers prouvant qu’ils avaient des mères-chats, des pères-chats, des grands-mères et grands-pères chats. En conséquence, à Paris, rongée, vidée, dévorée par les rats, si vous commenciez à les chercher, vous n’en trouveriez pas un seul. Je ne sais pas pourquoi cette histoire me fait penser aux Juifs. »
- extrait de l’héritage journalistique de Robert
Après la libération, Brasillach ne s’enfuit pas avec les Allemands. Il resta en France, se cacha un temps, puis se rendit volontairement aux autorités de la république restaurée. Le procès de janvier 1945 condamna le collaborateur à mort, après quoi le condamné paniqua et demanda la clémence à ses ennemis. Mais le général Charles de Gaulle, alors à la tête du gouvernement provisoire, rejeta la demande. Le 6 février 1945, Brasillach fut fusillé.

L’exécution du rédacteur en chef de Je suis partout engendra un long débat dans la société française. La condamnation de Brasillach fut publiquement critiquée par l’écrivain résistant François Mauriac : il estimait inutile de créer des martyrs pour une cause injuste, que le traître pourrisse en prison. D’autres étaient gênés que Brasillach, jamais caché, ait été fusillé alors que des milliers de collaborateurs « silencieux » — fonctionnaires, fournisseurs de nourriture pour la Wehrmacht, entrepreneurs de travaux pour elle — vivaient tranquillement sous la république restaurée. D’autres encore doutaient de la justice même du procès de janvier. Car son président, tout comme l’accusé, avait travaillé toute l’occupation pour les vichystes.
Brasillach ne fut pas la seule victime de la lutte pour une cause injuste. Entre 1944 et 1951, plus de 6700 personnes furent condamnées à mort en France pour collaboration, et environ un quart de ces verdicts furent exécutés par les soldats. Le pays tenta de laver son honneur et d’effacer de la mémoire collective ces quatre années « noires ». Mais qu’avaient donc fait les Français pendant cette période ?
Tant qu’il n’y a pas de guerre
L’expérience française de la Première Guerre mondiale aide en partie à comprendre le comportement de la société française durant la Seconde. Entre 1914 et 1918, contrairement aux autres grandes puissances, les Français ont combattu sur leur propre territoire. Parfois, même Paris devenait une ville de front.
Les pertes françaises furent énormes : plus d’un million de morts, soit plus de 5 % de la population masculine. Elles étaient d’autant plus terribles chez les 18-25 ans, où la part des tués au front atteignait un monstrueux 30 %. La réalité d’après-guerre fut marquée par d’innombrables orphelins, invalides, veuves et femmes célibataires. Dans ce contexte, une allergie massive à l’idée même d’une nouvelle guerre paraît compréhensible. D’autant plus qu’en 1919, la France avait atteint tous ses objectifs politiques lors du traité de Versailles.
« En France, un deuil national régnait pour les victimes de la guerre. La victoire arrachée à grand-peine était vécue très durement, soutenue par l’espoir que les Boches [les Allemands] paieraient tout avec des réparations. On considérait qu’il fallait tout faire pour que la guerre de 1914-1918 reste le dernier des derniers, « la dernière des dernières » »
- Evguenia Obitchkina, historienne russe
Cependant, dans les années 1930, le pacifisme parisien prit une tournure moins élégante. Paradoxalement, une partie sensible de la société glissait vers l’anglophobie. Et c’est justement dans les milieux de droite que l’on détestait le principal allié. Les grands industriels, hauts fonctionnaires et généraux voyaient les Britanniques comme des lâches aimant profiter des conflits en récoltant les fruits par procuration. Selon eux, si une nouvelle guerre éclatait, il serait douteux de s’y engager aux côtés de « l’Île perfide ».

Les sentiments anti-britanniques et, par conséquent, anti-américains se renforcèrent avec la Grande Dépression. Pour plusieurs raisons macroéconomiques, la crise toucha la France vers le milieu des années 1930. Cela donna aux extrémistes de droite un prétexte pour lier la montée du chômage et l’effondrement bancaire aux manigances des perfides Anglo-Saxons, derrière lesquels se tenaient évidemment les puissants juifs.
Oui, la France restait encore une république parlementaire dominée par des partis modérés. Mais dans l’Europe des années 1930, la démocratie n’était guère appréciée : un pays après l’autre, les voisins basculaient vers l’autoritarisme. De plus en plus de Français se demandaient : à quoi bon la Troisième République si les gouvernements ne résolvent pas les problèmes économiques et abandonnent leurs pouvoirs aux premiers signes de difficulté ?
Même les communistes font le salut nazi
Entre 1930 et 1940, Paris vit défiler 28 gouvernements. Pourtant, rien ne changeait fondamentalement : le pouvoir restait entre les mains d’un cercle étroit de politiciens, souvent liés par leur appartenance à des loges maçonniques et d’autres relations informelles. Dans cette décennie troublée, le socialiste Pierre Laval (futur Premier ministre sous Vichy) forma quatre gouvernements, tandis que le centriste Édouard Daladier (un des signataires de l’accord de Munich) en forma cinq.

La politique française dérivait vers un jeu entre amis où la volonté des électeurs comptait peu, et où les questions importantes se réglaient à huis clos. Entre 1936 et 1938, la partie la plus honnête du paysage politique français tenta de briser le système. Deux fois, le gouvernement du Front populaire, large coalition de gauche dirigée par le socialiste Léon Blum, arriva au pouvoir. Mais toutes ses tentatives de réformes sociales échouèrent. Comme l’écrivait plus tard l’historien britannique Julian Jackson, « l’héritage du Front populaire fut l’échec et la déception ».
L’effondrement des gouvernements Blum confirma une tendance déjà apparue : un large désenchantement envers le socialisme. Des militants de gauche réexaminaient leur agenda et se transformaient en populistes d’extrême droite. Le fait est que, en 1936, le parti pro-nazi PPF (Parti Populaire Français) fut fondé par Jacques Doriot, ancien membre du bureau politique du PCF, ayant séjourné à Moscou et connu personnellement Vladimir Lénine.

Indéniablement, l’acte de Doriot peut être considéré comme une trahison, mais en un sens, le futur collaborateur se montra un vrai politicien. L’ancien léniniste suivait son électorat, et à la fin des années 1930, de plus en plus de Français préféraient le chef autoritaire, l’antisémitisme et le nationalisme ethnique aux vertus traditionnelles de la république. Comme le déclarait un autre leader d’extrême droite, Marcel Bucard, chef du PPF hostile, le « Mouvement franciste » :
« Nos pères voulaient la liberté — nous exigeons l’ordre. Ils prônaient la fraternité — nous affirmons la discipline des sentiments. Ils prêchaient l’égalité — nous affirmons la hiérarchie des valeurs. »
C’est dans cet état d’esprit que la France entra dans la Seconde Guerre mondiale le 3 septembre 1939. La rue était tenue par l’extrême droite ; le PPF collaborait étroitement avec le crime organisé dans les ports du sud. Et dans les hautes sphères, siégeaient des messieurs qui n’étaient pas du tout désireux de se battre jusqu’au bout contre l’Allemagne.
Cherchez la femme
Le gouvernement avant-dernier de la Troisième République était dirigé par un candidat pas si mauvais, le libéral Paul Reynaud. Il était clairement en faveur de la résistance contre les nazis. Pourtant, ce Premier ministre respectable posa malgré lui une bombe sous son propre État.
L’influence politique démesurée de sa maîtresse, la comtesse Hélène de Port, grandit sous Reynaud. Les esprits malicieux la surnommaient la « Porte de côté » (La porte à côté), avec une allusion claire : par la comtesse, on pouvait régler des affaires en contournant son partenaire de chambre. Et avec le début de la guerre, le salon de de Port devint un cercle d’antibritanniques, d’antirépublicains et de pro-allemands. Leur icône était le maréchal Philippe Pétain, 84 ans, héros reconnu de la Première Guerre mondiale.

On disait que, dès le milieu des années 1930, l’extrême droite avait proposé à Pétain de diriger un coup d’État contre les démocrates, mais le vieil homme s’abstint. Pourtant, le maréchal contribua indirectement à la future catastrophe militaire de la France. Il utilisa son influence dans l’armée pour défendre deux thèses fatales : le développement des forces blindées était trop coûteux, et construire des fortifications dans les Ardennes frontalières de la Belgique était inutile, car il y avait déjà des montagnes imprenables. Comme on le sait, au printemps 1940, tout se passa à l’opposé des prévisions de Pétain.
À la mi-juin, le front s’effondra, les alliés britanniques s’enfuirent vers leur île, et Reynaud, pourtant prêt à se battre, se retrouva isolé politiquement. Le 16 juin, ce politicien ruiné céda son poste à Pétain, qui appelait ouvertement à un armistice avec les Allemands. Il le déclara directement à Winston Churchill, arrivé précipitamment sur le continent.
« Churchill soutenait que les Français avaient tort, et cita les paroles [du Premier ministre de la Première Guerre mondiale Georges] Clemenceau : « Je me battrai devant Paris, dans Paris et pour Paris ». En réponse, Pétain « calmement et avec dignité » fit remarquer que Clemenceau disposait d’une réserve stratégique de 60 divisions, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Transformer Paris en ruines n’aurait aucune influence sur l’issue de la guerre. »
- John Norwich, historien britannique
Le 17 juin 1940, Pétain appela les Français à cesser une lutte vouée à l’échec. Comme il le déclara, dans les semaines à venir, les Allemands « tordront le cou aux Anglais comme à des poussins ». Le 22 juin, dans la forêt de Compiègne, les parties signèrent un accord triomphal pour le Troisième Reich et douloureux pour la Troisième République. À la demande de Hitler, les généraux allemands acceptèrent la reddition non seulement au même endroit où la Première Guerre mondiale s’était terminée 22 ans plus tôt, mais littéralement dans le même wagon de commandement — pour symboliquement effacer l’amertume de l’automne 1918.

La France était figée. Les départements du nord se vidèrent de leurs habitants, et les routes vers le sud se remplirent de convois de réfugiés. Presque chaque soldat de l’armée vaincue avait un proche au front, mais personne ne savait ce qui attendait les 1,8 million de prisonniers de guerre. L’espoir vague d’un avenir meilleur reposait sur la figure du nouveau chef du gouvernement — un homme en uniforme, pas un bavard civil. Après tout, Pétain défendit devant les « Boches » une souveraineté partielle de la France et le maintien des colonies d’outre-mer. Ce n’était déjà pas si mal.
Autour du maréchal se forma un nouveau régime politique. Les milieux de droite étaient convaincus que la catastrophe de mai-juin 1940 était la fin logique de la « république sans colonne vertébrale » : les démocrates avaient renié les valeurs traditionnelles, corrompu la nation et l’avaient entraînée dans une guerre perdue d’avance. Il était temps de réparer cela. Très probablement, les partisans de Pétain croyaient sincèrement qu’ils sauvaient la patrie — ils ne pouvaient pas simplement se rendre à l’ennemi.
Un triomphe pour le vaincu
Le 3 juillet 1940, les maréchalistes furent involontairement aidés dans leur conquête de popularité par les marins britanniques. À Mers-el-Kébir, en Algérie, la Royal Navy attaqua un groupe de navires français dont les officiers avaient rejeté l’ultimatum des anciens alliés — livrer les bateaux ou les couler eux-mêmes. Les Anglais détruisirent un seul cuirassé et endommagèrent trois transports. Pourtant, cette attaque stratégiquement insignifiante coûta la vie à près de 1300 marins français.

Sur le continent, cet épisode convainquit beaucoup d’hésitants : les « rosbifs » étaient bien pires que les « Boches », et Pétain avait raison de rompre avec les insulaires. Le 10 juillet 1940, dans la ville de Vichy, le maréchal connut un triomphe politique. Les députés des deux chambres du parlement, réunis dans cette station thermale, votèrent les pleins pouvoirs exceptionnels à Pétain en tant que nouveau chef de l’État, et l’abrogation de fait de la Troisième République, qui avait duré 65 ans (569 voix pour, 80 contre et 19 abstentions).
« Notre défaite est le résultat de notre relâchement. L’état de permissivité a détruit tout ce qui avait été créé par un esprit de sacrifice. C’est pourquoi je vous appelle avant tout à un renouveau intellectuel et moral. »
- extrait du discours radiophonique de Pétain du 25 juin 1940
La solennité du moment fut un peu gâchée par le lieu de la cérémonie. Les organisateurs choisirent le plus grand cabaret de Vichy, car il n’y avait pas de salle plus grande dans cette petite ville. La capitale de fait de la « zone libre » resta donc une station thermale. Les grandes villes évitant l’occupation — comme Lyon, Toulouse ou Marseille — étaient considérées comme trop républicaines dans l’esprit de leurs habitants, ou simplement trop criminogènes.
Les premiers pas du nouveau régime ne firent pas fuir ses partisans. Le gouvernement pétainiste — dirigé par le socialiste Pierre Laval, qui avait su s’adapter — résolut avec succès les problèmes du pays vaincu. Les vichystes démobilisèrent rapidement les restes de l’armée française et aidèrent les habitants du nord, fuyant en mai 1940, à retourner chez eux dans des départements déjà occupés.

Le gouvernement Laval obtint également des nazis la libération d’une partie des prisonniers de guerre. Les nouvelles autorités luttaient contre le chômage, fixaient des prix maximum et introduisaient des allocations pour les concitoyens dans le besoin. Ces initiatives étaient accompagnées d’une rhétorique compréhensible pour les habitants des zones rurales : la France n’avait pas été elle-même trop longtemps, d’où ses malheurs au printemps 1940.
Le pays devait maintenant revenir à ses racines : au foyer familial, aux champs de campagne, à la douce pénombre de l’église. Les vichystes rendirent aux clercs les écoles publiques, compliquèrent la procédure de divorce et introduisirent des avantages pour les citadins décidant de vivre du travail agricole. Mais les couleurs et les aides pour peindre cette pastorale bienheureuse n’étaient pas les plus appropriées chez le maréchal Pétain.
Une collaboration désavantageuse
Formellement, le État français était considéré comme une puissance non alignée, ne participant pas à la Seconde Guerre mondiale. Dans ce statut, les pétainistes furent initialement reconnus comme pouvoir légitime par l’URSS, les États-Unis, la plupart des pays européens et même quelques dominions britanniques. Mais ce neutralité était dès le départ suspendue à un couperet.
D’abord, le Troisième Reich imposa à Pétain le paiement de réparations sous forme de « compensation des frais d’occupation ». Fin 1943, près de 25 milliards de Reichsmarks avaient été versés dans les caisses allemandes. La contribution imposée par Vichy était si exorbitante que les nazis la prélevaient sous toutes les formes possibles, des concessions à l’étranger aux carcasses de bétail abattu. En fait, la France était devenue une semi-colonie du Reich, et la politique hitlérienne détruisait directement l’économie vichyste.

En réponse, Pétain et Laval attirèrent au gouvernement plusieurs personnalités compétentes, dirigées par le ministre des Finances Yves Bouthillier. Ce dernier se présentait comme un technocrate, affirmant être étranger au fascisme — il voulait simplement aider le pays en temps difficile. Pendant un an et demi, le ministre soutint effectivement une forme de vie normale : avec des prix stables, des salaires fixes et quelques prestations sociales pour les citoyens.
Mais à l’hiver 1942, les ultra-droitiers, qui ne faisaient pas confiance à Bouthillier, firent pression pour sa démission, après quoi l’économie vichyste s’effondra logiquement. En 1944, l’indice de production industrielle de la France avait chuté de 2,5 fois par rapport à 1938, et le volume des exportations avait été divisé par quatre sur la même période. Pire encore, les nazis empoisonnaient non seulement la vie économique de la « zone libre ».

Dès octobre 1940, les Français furent contraints d’adopter des lois antisémites, presque copiées sur les originaux allemands. Au début, beaucoup se rassuraient en pensant que ce n’était qu’une formalité nécessaire pour amadouer les voisins et continuer à collaborer (collaborer), comme l’appelait le maréchal Pétain après sa rencontre personnelle avec Hitler. Bien sûr, c’était un nouvel auto-persuasion.
« Je me souviens encore d’un officier de police français, pas allemand, qui insultait ma mère et la frappait. Je ne peux pas oublier ça. […] Certains Français détournaient le regard pour ne pas voir les femmes et les enfants juifs, dans quel état nous étions alors. Mais la majorité accomplissait ses devoirs avec zèle et sans émotion. »
- Annette Müller, témoin de l’Holocauste en France
À l’hiver 1942, de nouveaux actes « raciaux » privèrent les Juifs français de tous leurs droits humains et civiques. À l’été 1942, le pays vit des rafles systématiques du peuple persécuté, et tous les arrêtés étaient immédiatement déportés vers les camps de la mort en Pologne. Au total, au moins 74 000 Juifs français, soit environ un quart de la communauté d’avant-guerre, furent victimes de l’Holocauste.
***
D’une certaine manière, les Français restèrent fidèles à eux-mêmes même après s’être engagés sur la pente glissante de la collaboration. Contrairement à la plupart des satellites du Reich, plusieurs partis pro-nazis coexistaient ici : les « francistes » mentionnés plus haut avec le PPF, et leurs concurrents avec différents accents idéologiques.
Mais les partenaires allemands méprisaient tous leurs imitateurs de la même manière. Aucun des mouvements d’extrême droite n’obtint la bénédiction d’Hitler : même la formation de plusieurs unités volontaires pour combattre l’URSS n’y changea rien. Et à l’automne 1942, après que les colonies françaises d’Afrique passèrent du côté des Alliés, Berlin décida de mettre fin à la « zone libre ». Le 11 novembre 1942, les troupes germano-italiennes occupèrent toute la France.

À ce moment, la majorité silencieuse des Français comprit que le seul moyen de sauver le pays n’était pas dans les compromis, mais dans la lutte, et que la « France combattante » du général de Gaulle était bien plus qu’une milice au service des Anglais détestés. La résistance au nazisme prit enfin un caractère national : en métropole comme dans ses nombreuses possessions. Beaucoup durent renoncer à leurs illusions initiales, et un nombre non moindre de leurs compatriotes payèrent leurs anciennes erreurs de leur vie.
Quoi qu’il en soit, la France réussit à sauver son indépendance et son honneur national. Même si parfois ce furent les mêmes personnes qui, à l’été sombre de 1940, faillirent livrer leur pays à un voisin ultra-toxique.
« On ne peut pas décrire tout ce qui s’est passé en France pendant les « années noires » uniquement avec les termes « collaboration » et « Résistance ». Ces termes désignent deux pôles entre lesquels s’étend un spectre entier de situations, de positions, d’humeurs, changeant dans le temps et dans l’espace. Une personne pouvait se déplacer sur ce spectre d’un pôle à l’autre sans pour autant être un opportuniste vulgaire. Par exemple, [le futur président] François Mitterrand, d’abord fervent partisan de Pétain, devint un membre actif de la Résistance. Son exemple illustre bien comment la position de nombreux Français a évolué. »
- Henri Russo, historien français
Sources principales de l’article :
- Gaïvoronsky K. La mort du propagandiste. Pourquoi et comment le plus célèbre écrivain-collaborateur français a été jugé
- Mikheev K. La politique socio-économique du gouvernement de Vichy en France
- Norwich J. Brève histoire de la France
- Obitchkina E. Le régime de Vichy
- Reese L. L’Holocauste : une nouvelle histoire
- Russo A. La France de Vichy et la France de la Résistance
- Evans R. Le Troisième Reich : les jours de guerre
Sur la photo principale — la poignée de main historique entre Philippe Pétain et Adolf Hitler, le 24 octobre 1940. À l’issue de la rencontre, le maréchal français appela ses concitoyens à « collaborer » (collaborer) avec l’Allemagne — ce mot prit par la suite une connotation négative. Photo : Bundesarchiv, Bild 183-H25217 / CC-BY-SA 3.0