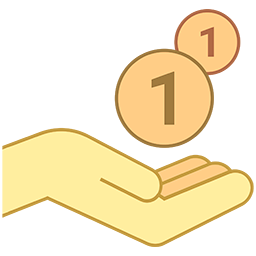Soutenez lauteur !
Lécrivain du serpent russe. À loccasion du septantième anniversaire de Vladimir Sorokine

Nous sommes depuis longtemps à l'intérieur de son infinie Tellurie, nous vivons à l'intérieur de sa prophétie auto-réalisatrice, nous roulons à l'intérieur de la Machine de violence qu'il a décrite. Et on ne peut pas dire qu'on ne nous ait pas prévenus ; une prédiction aussi claire – au cours des dernières décennies avant la catastrophe – la littérature russe ne l'avait encore jamais connue.

Publication préparée par le projet média « Pays et Monde — Sakharov Review » (télégramme du projet — « Pays et Monde »).
Quand nous disons que quelque chose se passe « à la manière de Tchekhov, à la manière de Tolstoï, à la manière de Dostoïevski », cela signifie une vision du monde à travers des lunettes uniques, qui permettent de saisir le monde dans son ensemble – mais chaque fois différemment. Voir le monde « à la manière de Sorokine » signifie « rire à travers l'inconscient », un sourire amer d’une personne qui comprend toute la tragédie de sa situation existentielle.
L’écriture sorokinienne, entre autres, est très démocratique ; elle accueille chacun – qui veut, bien sûr, entrer. « La merde » qui nous attend à l’entrée (selon l’expression des détracteurs de Sorokine) est simplement une exigence radicale envers la personne du XXIe siècle, une disposition critique à se découvrir nu, sans béquilles, face à l’être. Rester seul avec l’essence effrayante de ce qui se passe, « dire la vérité » – d’abord à soi-même (un refrain de la « Trilogie glacée » de Sorokine).
Le respect des convenances extérieures, la fidélité aux traditions et l’absolutisation de la culture en tant que telle ne sont en aucun cas devenus un obstacle au fascisme, écrivait Hannah Arendt. Ils ne furent pas non plus un obstacle pour d’autres totalitarismes, ajouterons-nous. Tous les tabous culturels aident plutôt le totalitarisme qu’ils ne le gênent, car ils établissent un barrage, une barrière à la pensée, empêchant de penser au-delà de ce qui est permis.
Cependant, l’absence de tabous n’est pas non plus une baguette magique universelle.
Le postmodernisme a été compris en Russie dans les années 1990-2000 notamment comme « tout est permis ». Et cette animalité insouciante à travers un rire cynique est un signe éclatant du nouveau mal.
La seule consolation est que le mal ne se fait plus d’illusions, même sur lui-même. Cette nudité, cette franchise du mal, « sans théories » – espérons que cela aidera, dans une perspective historique, à en reconnaître l’essence beaucoup plus rapidement qu’autrefois.
Dans l’URSS, il était d’usage, pour le 70e anniversaire des écrivains reconnus, de leur décerner le titre de héros du travail socialiste (dans le jargon de l’époque, « Gertrude »). Appliqué à Sorokine, cela sonne comme une blague préméditée. Mais sa méthode créative nous permet d’imaginer aussi cette utopie. Supposons que la « belle Russie du futur » veuille remercier Sorokine pour les sens qu’il a offerts et l’invite au palais du Kremlin pour lui épingler une étoile d’or sur sa veste. D’abord, cela reste impossible à imaginer même dans les meilleures hypothèses : avant tout parce qu’aucune idée de pouvoir, même « bonne », ne s’accorde avec Sorokine. Ensuite, les gens élevés sur les livres de Sorokine (s’ils l’ont bien compris) transformeront probablement le Kremlin en « sucré » – en une sorte d’attraction de divertissement, et non en symbole du pouvoir.
Sorokine mérite une autre récompense, symbolique : que les gens deviennent plus attentifs au mal. Le signal d’une fausseté idéologique est généralement une fausseté esthétique : le Sorokine précoce, qui a frappé le ventre du réalisme socialiste avec ses héros en carton et ses discours – tout cela en témoigne. Pourtant – paradoxe : Sorokine est très classique à la russe. Il pense en grandes masses, en grands concepts – et en termes de monumentalité de talent, il est l’héritier de la tradition tolstoïenne dans la littérature russe. L’une des descriptions les plus réussies de Sorokine que j’ai entendues : « le fils indocile de Tolstoï ». C’est amusant, mais on ne peut pas imaginer Tolstoï lui-même (contrairement, par exemple, à Dostoïevski !) allant au palais du souverain pour recevoir une récompense.
On ne peut pas dire que la littérature russe n’ait jamais travaillé sur la violence, qu’elle n’ait jamais averti du problème. Mais Sorokine l’a fait de la manière la plus cohérente, depuis le début de sa carrière à la fin des années 1970 – début des années 1980. Le réalisme socialiste aimait répéter des mots sur l’humanité, « rester humain ! » (à l’égard des siens, bien sûr, et non des ennemis du pouvoir soviétique). En ce sens, Sorokine correspond parfaitement à l’ancien canon : la violence est avant tout humaine.
La culture pré-révolutionnaire et soviétique (officielle comme dissidente) étaient convaincues que nous sommes globalement « bons », seule la système est mauvais. Il suffit de corriger le système – par exemple, mieux éclairer, ou mieux nourrir, sinon avec de la nourriture, au moins avec des idées – et l’homme deviendra meilleur. Après Sorokine, la culture russe est obligée de reconnaître que la « méchanceté » de l’homme est quelque chose d’essentiel, qui lui est intrinsèque dès l’origine.
Dmitri Bykov (également admirateur de Sorokine) a un poème des années 1990 disant que ce ne sont pas tant les manifestations pratiques de la violence qui font peur, mais la conscience que c’est « possible ».
Sorokine a montré que l’homme lui-même, soviétique ou post-soviétique, est capable de tout, du pire. Et aujourd’hui cette hypothèse est confirmée par des millions d’exemples – avec la franchise sorokinienne ; le meurtre de masse est devenu un travail rentable et lucratif, et des millions s’y adonnent.
Un autre thème, un motif récurrent chez Sorokine ces dernières décennies – la disparition de la culture russe au XXIe siècle, la disparition progressive de cette monnaie dans les échanges mondiaux. L’image la plus terrible chez Sorokine – dans « L’Héritage » (2023) – est celle des locomotives noyées sous des corps humains dans une sorte de post-Russie. C’est un symbole de déshumanisation, bien sûr. Mais cette image a aussi une autre interprétation : depuis 20-30 ans, la culture russe noyait sa locomotive avec les thèmes et les idées des classiques morts, l’esprit et les espoirs du passé. Au début, cela donnait une certaine chaleur, mais maintenant la réserve est épuisée. Et aucune nouvelle réserve n’a été créée.
Dans les années 1990, il y avait l’espoir d’une amélioration générale des mœurs. Quelque chose d’inévitablement bon devait arriver de lui-même – après tant de souffrances dans le passé, de plus – « c’est tellement naturel ! » (dans cette croyance, il y avait probablement des échos de l’ancienne conviction marxiste en la « loi de l’histoire, forces motrices », etc.). Bien sûr, le soviétique ne disparaîtra pas immédiatement – il est attendu une période de demi-décomposition. Le symbole de cette demi-décomposition était la célèbre nouvelle de Sorokine dans « Norma » (1979), appelée dans le peuple « Martin Alexeïevitch ». Le discours obsessionnel du protagoniste, le scintillement de sa conscience entre banalité et folie – beaucoup pensaient que c’était le processus de décomposition du soviétique, en molécules, en atomes de parole. Avant de disparaître définitivement dans le néant, le soviétique doit s’exprimer jusqu’à la lettre, jusqu’à l’interjection, vomir tout jusqu’au point final. Et la nouvelle propagande était vue comme ce « Martin Alexeïevitch », la dernière phase de l’incontinence verbale. « Mais un jour, ils finiront par s’exprimer complètement ! » – pensait-on.
C’était une autre illusion générale – et sans doute aussi celle de Sorokine lui-même – que la conscience totalitaire disparaîtrait d’elle-même. Elle ne part pas toute seule – voilà la découverte la plus tragique du XXIe siècle. Pour qu’elle disparaisse, des efforts sont nécessaires de la part de chacun (il n’est pas clair, toutefois, quels efforts exactement : l’appel à la raison, à la rationalité, comme nous le voyons, ne sont pas la clé de la conscience totalitaire). Le totalitarisme s’est avéré capable d’une reproduction infinie – acquérant à chaque fois des formes de plus en plus effrayantes. La nouvelle réincarnation de « Martin » – le philosophe Douguine, qui propose à tous de brûler ensemble dans le feu de l’histoire sur une broche nucléaire, et ainsi, enfin, de « se purifier ».
Quelles paroles trouver aujourd’hui pour labourer ce champ d’expériences russe sans le brûler entièrement ? Le paradoxe du temps post-catastrophique : beaucoup de mots du lexique ancien paraissent désormais infiniment faux. Aujourd’hui, on ne peut lire que ce qui ne promet pas une sortie rapide du cauchemar : Kafka, Beckett, Kharms – et Sorokine.
Il est surprenant que Sorokine cherche aujourd’hui des mots de consolation – pour cela, il se tourne souvent vers les récits féeriques et populaires. Le temps féerique est infini, non normé – en ce sens, il possède une certaine résistance. Un autre point important : le conte est un mécanisme d’initiation répétée, la capacité du héros à se renouveler. Certes, pour cela, le héros féerique doit passer une série d’épreuves. S’il réussira – et nous avec lui – Dieu seul le sait ; mais ce regard sur la réalité cauchemardesque offre au moins un soutien psychologique – et laisse une option d’espoir.