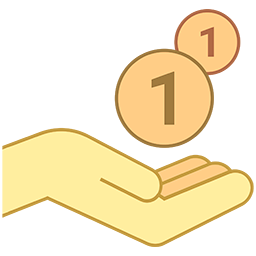Soutenez lauteur !
Plus de deux mille otages, des dizaines de victimes et le mensonge des services spéciaux : 30 ans depuis l’attentat de Kizliar et Pervomaïskoïe

À l’hiver 1996, à Kizliar, presque deux fois plus d’otages ont été pris qu’à Boudionnovsk six mois plus tôt ; à ce jour, cet attentat au Daghestan reste le plus important de l’histoire nationale (et, semble-t-il, mondiale) en nombre d’otages. Cette crise a appris aux ministres et généraux russes que la force prévaut sur les mots, et que toute perte humaine vaut mieux que perdre la face.

Il y a exactement 30 ans, le 22 janvier 1996, Moscou enterrait des membres des forces de l’ordre. Il s’agissait de combattants du SOBR de la capitale, qui ne sont pas revenus d’une mission dans le Caucase du Nord — ils étaient partis libérer les habitants du Daghestan pris en otage par des séparatistes tchétchènes. Le journal « Kommersant » a alors publié un reportage remarquable sur la cérémonie funèbre et la conférence de presse de la hiérarchie policière. Aujourd’hui, il apparaît comme un précieux témoignage de cette époque lointaine — quand l’État russe ne contrôlait pas encore tout son territoire revendiqué, mais où les médias proches du pouvoir pouvaient encore publier sans conséquences la vérité crue de la guerre.
Le titre de l’article est révélateur : « L’assaut affamé ». En effet, à Pervomaïskoïe, les fédéraux, mal approvisionnés, manquaient non seulement d’armes, mais aussi tout simplement de nourriture et de chauffage. Lors de l’assaut décisif, les forces de l’ordre étaient affamées et transies de froid, alors qu’à quelques pas de là se trouvait un quartier général avec des chefs venus de Moscou et des journalistes ; eux, bien sûr, ne connaissaient pas ces problèmes. Comme l’a confié à des journalistes un membre du SOBR, « on nous avait tellement frigorifiés qu’on se fichait bien de mourir du froid ou d’une balle. Heureusement qu’on a pensé à prendre de la vodka avec nous. »
Mais déjà au milieu des années 2000, ces détails et la tragédie de Kizliar et Pervomaïskoïe dans son ensemble ont été discrètement oubliés. Pourtant, ces deux semaines noires de janvier 1996 pour le Daghestan sont essentielles pour comprendre l’histoire récente de la Russie. En gérant à la volée cette crise des otages, les autorités russes et leurs forces de l’ordre ont élaboré des méthodes qu’elles suivront pendant de nombreuses décennies.
Un remake que personne n’a demandé
Le plan des séparatistes est facile à comprendre : ils voulaient répéter et amplifier ce qu’ils avaient réussi à Boudionnovsk, dans le kraï de Stavropol, en juin 1995 (cette tragédie a été racontée en détail par « Most »). Prendre des otages, obtenir de Moscou les concessions politiques voulues et revenir sur le territoire contrôlé par la direction de la « République tchétchène d’Itchkérie ». Et aussi rappeler au monde que les autorités russes sont non seulement impuissantes à reprendre la Tchétchénie, mais qu’elles ne contrôlent même pas réellement les régions voisines de la république rebelle.
À l’été 1995, après la tragédie de Boudionnovsk, le commandant de terrain Chamil Bassaïev a arraché aux autorités fédérales une trêve avantageuse pour ses compagnons. Tant bien que mal, avec de nombreuses violations, elle a duré jusqu’à la fin de l’automne. Ensuite, les séparatistes ont estimé avoir assez de forces pour reprendre les combats. En décembre 1995, les formations de la « République tchétchène d’Itchkérie » ont imposé à l’ennemi une semaine de combats pour Goudermes. Les fédéraux ont tenu la deuxième ville de Tchétchénie, mais la victoire psychologique est restée aux combattants — la société russe s’est à nouveau convaincue que son armée ne gagnait en rien la guerre.

Le leader de la « République tchétchène d’Itchkérie », Djokhar Doudaïev, a voulu consolider ce succès avec un second raid hors de Tchétchénie. À l’été 1995, les séparatistes avaient choisi Boudionnovsk comme cible de façon spontanée. Cette fois, Doudaïev a délibérément choisi Kizliar — une petite ville multiethnique (43 600 habitants à l’époque) au nord-ouest du Daghestan. D’un côté, Kizliar était géographiquement proche, à quelques kilomètres de la frontière tchétchène. De l’autre, il y avait là des infrastructures fédérales : une unité de troupes internes, un aérodrome militaire et une usine liée à la défense.
Il s’agissait de frapper ces cibles le plus durement possible et, « par tradition », de prendre à Kizliar le plus d’otages possible. Mais Doudaïev a commis une erreur dès la planification du raid. À Boudionnovsk, Bassaïev commandait seul, mais pour cette nouvelle opération, deux chefs étaient prévus. En pratique, c’est Khounkar-Pacha Israpilov qui devait diriger les combattants : sous l’URSS, il avait reçu une formation militaire supérieure, puis combattu au Haut-Karabakh (côté azéri) et en Abkhazie (côté séparatiste). « Politiquement », c’est Salman Radouev qui devait apparaître comme le chef, son influence tenant au fait qu’il était marié à la nièce de Doudaïev. Contrairement à la plupart des membres de la « République tchétchène d’Itchkérie », Salman n’avait ni expérience militaire ni passé criminel. Jusqu’en 1991, il était membre du PCUS et faisait carrière dans la voie du Komsomol.

L’absence de commandement clair a joué un mauvais tour aux hommes de Doudaïev pendant la crise au Daghestan. La « chimie » entre les deux partenaires laissait clairement à désirer. Israpilov lui-même critiquait les décisions de Radouev même devant les caméras des chaînes russes.
Pas de troisième fois
Derrière ces deux commandants se trouvait un groupe important pour la « République tchétchène d’Itchkérie » : 250 volontaires expérimentés, motivés et bien équipés. D’après divers témoignages, les hommes de Doudaïev à Pervomaïskoïe — contrairement à leurs adversaires — ne manquaient ni d’armes ni de munitions, ni d’équipement (même des lunettes de vision nocturne), ni de moyens de communication. Pendant tout le raid, les séparatistes interceptaient régulièrement les communications fédérales, qui peinaient souvent à joindre leurs propres collègues d’autres services.

La partie russe a ensuite attribué la combativité de l’ennemi au fait que, dans le groupe d’Israpilov et Radouev, il y aurait eu surtout des combattants venus du Moyen-Orient, et non des Tchétchènes. Ce n’est pas exact, même si quelques mercenaires arabes ont effectivement participé au raid daghestanais. Plus intéressant encore : certains anciens militaires russes, passés du côté de la « République tchétchène d’Itchkérie », combattaient avec eux. Le journaliste Valeri Iakov se souvenait avoir rencontré parmi les assaillants de Kizliar un jeune Russe — un conscrit qui, fait prisonnier, s’était converti à l’islam et avait adopté les idées séparatistes. Alors qu’il attendait le dénouement avec ses nouveaux compagnons, il a transmis par Iakov un mot à sa famille : « Si Dieu le veut, on se reverra. En attendant, je me bats pour la liberté et l’indépendance de la Tchétchénie. Je vous embrasse. »
Cela se passera un peu plus tard, à Pervomaïskoïe. Mais que s’est-il passé à Kizliar ? Tôt le matin du 9 janvier, les hommes de Doudaïev — qui s’étaient infiltrés la veille en petits groupes au Daghestan — ont attaqué la ville. L’effet de surprise jouait en leur faveur, car les services spéciaux russes avaient ignoré les informations sur un attentat en préparation. Mais les assaillants ont aussi commis une erreur : leur renseignement leur a transmis des données inexactes sur les forces fédérales en ville. Les groupes d’Israpilov et Radouev ont donc raté leurs attaques sur l’aérodrome, la caserne des troupes internes et d’autres cibles, perdant quelques dizaines de compagnons. Après ces échecs contre des adversaires armés, les assaillants ont décidé de s’en prendre aux civils — de répéter le crime de Bassaïev à Boudionnovsk.
Là, les combattants n’ont rencontré aucun problème, d’autant que la ville était en plein chaos après l’attaque surprise.
Profitant du chaos, les séparatistes ont rassemblé dans l’hôpital de la ville, le 9 janvier, pas moins de 2 117 otages. Ceux qui tentaient de résister étaient exécutés sur place.
Ensuite, comme à Boudionnovsk, les hommes de Doudaïev ont piégé le bâtiment, fait venir des journalistes et lancé des revendications politiques — retrait des troupes fédérales de Tchétchénie, rencontre personnelle entre Eltsine et Doudaïev, et annulation des résultats des élections organisées par Moscou dans la partie contrôlée de la république.

Israpilov pensait que les séparatistes pourraient obtenir du Kremlin des concessions significatives, voire surpasser le succès de Bassaïev à l’été.
En effet, à Kizliar, presque deux fois plus d’otages ont été pris qu’à Boudionnovsk ; sur ce critère, l’attentat au Daghestan reste à ce jour le plus important de l’histoire nationale (et, semble-t-il, mondiale).
Mais Radouev, même s’il jouait devant les caméras les durs, n’était pas pressé de risquer sa vie. Par téléphone satellite, il a exposé la situation à Doudaïev, qui a donné son feu vert pour que le groupe retourne en Tchétchénie sans résultat politique : selon lui, le choc médiatique de Kizliar à la télévision était déjà un succès suffisant pour la « République tchétchène d’Itchkérie ».
Cette logique convenait aux autorités daghestanaises. Le chef de la région, Magomedali Magomedov, a immédiatement engagé des négociations avec Radouev pour obtenir le départ sans délai des visiteurs indésirables de sa république. Après quelques hésitations, ils ont accepté et les parties ont trouvé un compromis. Les combattants et les Daghestanais sont convenus que les premiers libéreraient les habitants de Kizliar capturés, et que les seconds fourniraient aux hommes de Doudaïev des bus et dix fonctionnaires locaux comme boucliers humains. Ensemble, ils atteindraient la frontière tchétchène-daghestanaise et se sépareraient — selon le même scénario qu’à Boudionnovsk.
Mais le sommet du pouvoir russe voyait la situation tout autrement. Leur palette de sentiments et de pensées se résumait à une formule : Kizliar est un deuxième Boudionnovsk, et il ne doit pas y avoir de troisième attentat similaire.
Un komsomol à Pervomaïskoïe
Dès les premières heures après la tragédie, à Moscou, les positions « faucons » ont été prises par le ministre de l’Intérieur Anatoli Koulikov et le chef du FSB Mikhaïl Barsoukov. Le commandant du groupe fédéral en Tchétchénie, le général Viatcheslav Tikhomirov, s’est immédiatement montré solidaire. Les hauts responsables des forces de l’ordre ont catégoriquement écarté la possibilité de laisser passer le groupe Radouev-Israpilov vers la « République tchétchène d’Itchkérie », quoi que leur ait promis la direction daghestanaise.

Les « faucons » ont reçu le soutien du président Boris Eltsine. À l’hiver 1996, il avait décidé de briguer un second mandat, conscient de sa faible popularité. Son taux de popularité dépassait à peine 5 %, et le bloc présidentiel « Notre maison — la Russie » avait échoué aux élections législatives de décembre 1995 avec un peu plus de 10 % des voix. Eltsine et son équipe connaissaient les raisons de ce désastre électoral. En plus de toutes les difficultés socio-économiques liées à la chute de l’URSS, les gens étaient irrités par le fait que le Kremlin, ayant lancé la campagne en Tchétchénie, ne semblait pas savoir comment la mener.
Les échecs de l’armée étaient discutés en prime time sur les chaînes fédérales, et les funérailles de presque chaque soldat tombé devenaient un meeting contre la guerre.
Les images d’archives de janvier 1996 montrent à quel point Eltsine était en colère. Il s’en prenait à ses propres forces de l’ordre, fustigeait les journalistes, lançait des menaces à Doudaïev et à ses partisans. Mais cette colère venait en grande partie des reproches que Boris Nikolaïevitch s’adressait à lui-même. À l’été, lors de la crise de Boudionnovsk, le président s’était retiré du processus de décision. Les services spéciaux avaient alors raté l’assaut de l’hôpital pris par les combattants, et le Premier ministre Viktor Tchernomyrdine, qui avait pris la responsabilité, avait laissé partir le groupe de Bassaïev en échange de la libération des otages. En hiver, Eltsine fit clairement savoir qu’il ne voulait pas d’accord, mais une solution par la force.
« Je pense qu’on ne peut pas... Un État où il y a du pouvoir, un État où il y a de la force, [ne doit pas] tolérer sur son territoire de telles formations. Non ! Il faut en finir avec eux ! Les journalistes sont aussi coupables : déjà à l’époque [à Boudionnovsk], on pouvait régler la question avec eux, mais les journalistes ont fait du bruit. Voyez-vous, le bandit souffre quand il est blessé ! Voilà ! Les bandits, on les plaint ! »
— extrait d’une déclaration d’Eltsine à Moscou, 15 janvier 1996
Le matin du 10 janvier, le convoi de bus avec les combattants et les fonctionnaires daghestanais est parti de Kizliar. À la dernière minute, Radouev a changé d’avis et n’a pas libéré tous les « otages ordinaires », gardant une centaine de citadins avec lui par précaution. Vers 11h00, le convoi a atteint Pervomaïskoïe — un petit village sur la rive droite du Terek, à la frontière même de la Tchétchénie. Là se trouvait un poste de contrôle des forces fédérales, tenu par moins de 40 policiers venus de la région de Novossibirsk. On avait ordonné aux Sibériens de ne pas ouvrir le feu sur les visiteurs inattendus.
Ensuite, l’irréparable s’est produit. Des hélicoptères militaires, rattrapant le convoi, ont frappé le pont sur le Terek. La structure s’est aussitôt effondrée, privant le groupe de Radouev de sa précieuse échappatoire vers la « République tchétchène d’Itchkérie ». Les séparatistes ont compris qu’ils étaient tombés dans un piège et qu’ils allaient être attaqués au sol (en réalité, les forces spéciales russes, à cause d’une mauvaise coordination interservices, sont arrivées une à deux heures après l’effondrement du pont). Les hommes de Doudaïev ont alors pris le poste de contrôle et désarmé les policiers désorientés. Les hommes de l’ancien komsomol ont occupé Pervomaïskoïe, d’où presque tous les habitants ont fui dans la panique.

La situation a pris une tournure étrange. Les forces de l’ordre russes avaient obtenu le départ des combattants de Kizliar, mais leur avaient involontairement offert un nouveau point de défense potentiel. L’ennemi, de son côté, s’était rapproché de son territoire, mais était coupé de la « République tchétchène d’Itchkérie » par les eaux glacées du Terek. Pourtant, une semaine plus tard, Radouev et Israpilov ont trouvé la solution à cette énigme fluviale.
Feu, eau et tuyau
Eltsine a nommé le chef du FSB Barsoukov à la tête de l’opération au Daghestan. Tout le monde y a vu un nouveau signe que le président voulait une victoire militaire. Le prédécesseur de Barsoukov, Sergueï Stepachine, avait perdu son poste précisément parce qu’il n’avait pas su organiser une opération militaire efficace à Boudionnovsk.
Barsoukov lui-même n’était pas opposé à une « liquidation » de Pervomaïskoïe. Le chef d’état-major de l’opération, le général Dmitri Guérassimov, était d’un autre avis. Contrairement à son supérieur, qui avait fait carrière dans la garnison du Kremlin, Guérassimov était un véritable commandant des forces spéciales, issu du GRU soviétique, vétéran de l’intervention en Afghanistan. L’officier estimait sceptiquement l’idée d’assaut du village avec des dizaines d’otages. Guérassimov proposait raisonnablement d’attirer les combattants hors de Pervomaïskoïe et de les attaquer à nouveau sur la route.

Mais un autre problème se posait : après la destruction du pont sur le Terek, Radouev et Israpilov ne faisaient plus confiance aux représentants russes. Ils exigeaient désormais des garanties officielles et la venue à Pervomaïskoïe de hauts responsables politiques fédéraux. L’état-major de Barsoukov ne pouvait y consentir — seule une capitulation sans condition de l’ennemi pouvait empêcher la « liquidation » du village, ce qui était inacceptable pour les combattants de la « République tchétchène d’Itchkérie ». C’était un cercle vicieux.
En quelques jours, les fédéraux ont rassemblé autour de Pervomaïskoïe un groupe de 2 000 à 2 500 hommes issus du ministère de l’Intérieur, du FSB et des forces armées. C’était une force hétérogène, composée des forces spéciales « Alpha » du FSB, de leurs homologues des troupes internes, de membres du SOBR de différentes régions de Russie, et enfin des inévitables conscrits-motocyclistes et artilleurs. Il s’agissait de détachements très différents, avec des niveaux et des standards de préparation disparates. De plus, durant l’attente, le groupe devait se débrouiller sans nourriture normale ni abris chauffés : les hommes dormaient dans des trous et chassaient les vaches qui fuyaient le village. À la fin de la crise à Pervomaïskoïe, beaucoup de membres des forces de l’ordre tenaient à peine debout, épuisés par la faim, la fatigue et le froid.

Le 14 janvier, Radouev a définitivement rejeté l’ultimatum de reddition lancé par Barsoukov, arrivé sur place. Le 15 janvier, les fédéraux ont attaqué les hommes de Doudaïev de plusieurs côtés, sous prétexte que ceux-ci auraient exécuté une partie des otages et certains anciens du Daghestan venus raisonner les fanatiques. Les combats ont duré toute la journée, faisant des dizaines de morts des deux côtés sans apporter de succès aux forces de l’ordre. Les combattants de la « République tchétchène d’Itchkérie » ont conservé le centre du village, où ils retenaient la majorité des otages.
« Ils [les membres des forces spéciales] ne pouvaient plus marcher, mouillés, gelés, affamés. Fiévreux, avec de la température. Demain matin, ils devront à nouveau attaquer, fiévreux, affamés et sans assez de soutien de feu. »
— Pavel Goloubets, général des troupes internes, commandant de l’assaut de Pervomaïskoïe
Cela s’est répété les 16 et 17 janvier. Les fédéraux agissaient trop dispersés, et leur adversaire, profitant du temps d’attente, avait eu le temps — avec la participation forcée des policiers prisonniers du poste de contrôle — de bien s’enterrer à Pervomaïskoïe. Désespérés, les assiégeants bombardaient de plus en plus le village à l’aveugle : avec des roquettes non guidées depuis des hélicoptères et des systèmes Grad depuis le sol. Le porte-parole du FSB sur place, Alexandre Mikhaïlov, affirmait aux journalistes que « l’aviation travaille avec précision, aucun bâtiment avec des otages n’a été touché », et qu’il n’y avait aucune menace pour les prisonniers — selon lui, il n’y en avait « pratiquement plus ».
Il semblait que dans un ou deux jours, il ne resterait plus rien du groupe Radouev-Israpilov. Israpilov, belliqueux, proposait de placer les otages restants autour du village en ruines et de livrer un dernier combat. Mais Radouev, qui n’avait pas envie de mourir, proposa une nouvelle voie vers la Tchétchénie — en passant par le gazoduc qui surplombait le Terek près de Pervomaïskoïe. La structure était assez large pour que les fuyards l’utilisent comme un pont, sans avoir à ramper à l’intérieur au risque de leur vie. Et surtout, c’est justement près du Terek que le dispositif fédéral était le plus faible — soit parce qu’ils ignoraient l’existence du gazoduc, soit parce qu’ils en sous-estimaient les possibilités.

Quoi qu’il en soit, dans la nuit du 18 janvier, les hommes de Doudaïev, après de violents combats au corps à corps, ont percé les lignes ennemies et se sont dirigés vers le gazoduc, emmenant avec eux une partie des otages. Ce ne fut pas une victoire sans appel pour la « République tchétchène d’Itchkérie ». D’abord, presque tout l’avant-garde du groupe a péri lors de la percée, puis les hélicoptères russes ont frappé les combattants lors de la traversée. Des dizaines de combattants sont morts, et les survivants, sur la rive ouest tchétchène du Terek, ont dû s’éparpiller.
Quelques jours plus tard, le directeur du FSB Mikhaïl Barsoukov a expliqué en conférence de presse le succès partiel de la fuite ennemie par une ruse inhabituelle — « les combattants enlevaient leurs bottes et marchaient pieds nus ». Le chef du FSB s’est ridiculisé. Même les Russes les plus éloignés des structures de force comprenaient que les bottes des cadavres de combattants — que ses subordonnés lui avaient sans doute montrées — avaient été retirées par les soldats russes sous-équipés. Mikhaïl Ivanovitch a soit cru à ce mensonge évident, soit pensé que la société l’avalerait. Le journaliste Alexandre Minkine, célèbre dans les années 1990, a résumé : « Si la sécurité fédérale est entre les mains d’un tel homme, il ne fait aucun doute que la patrie est en danger. »
« Cygne blanc » et « cygne noir »
La crise de Kizliar et Pervomaïskoïe a été extrêmement sanglante selon les standards de la première guerre de Tchétchénie. Il n’existe toujours pas de statistiques officielles et reconnues sur les morts, mais il est certain qu’on parle de centaines de victimes des deux côtés.
Rien que lors de l’attaque des combattants contre la ville, 34 habitants ont été tués, dont des membres des forces de l’ordre. Lors de la « liquidation » de Pervomaïskoïe, 23 à 26 fédéraux sont encore tombés. Dans diverses circonstances, jusqu’au matin du 18 janvier, au moins treize otages n’ont pas survécu — certains ont bien été tués par les preneurs d’otages, mais beaucoup sont morts sous les tirs maladroits des « libérateurs ». De nombreuses dizaines de civils et de membres des forces de l’ordre ont été blessés à divers degrés.

Les pertes irréversibles de la « République tchétchène d’Itchkérie » sont estimées à environ une centaine de combattants. Autrement dit, environ la moitié du groupe initial de Radouev et Israpilov est morte — un chiffre inacceptable pour une république autoproclamée, surtout vu l’inutilité politique du raid. Contrairement à Bassaïev en 1995, Radouev, en hiver 1996, n’a ramené aucun accord ou compromis de l’ennemi. Beaucoup, dans la « République tchétchène d’Itchkérie », ont été scandalisés pour d’autres raisons : lors de la percée de Pervomaïskoïe, Israpilov et Radouev ont laissé à l’ennemi des dizaines de corps de compagnons et au moins 20 prisonniers. Selon la tradition montagnarde, une telle honte est impardonnable pour un chef militaire. En échange des morts et des prisonniers, les séparatistes ont dû remettre tous les otages restants.
Les deux commandants de terrain sont restés des figures importantes dans la vie politique de la république non reconnue, mais n’ont pas survécu à la deuxième guerre de Tchétchénie. Le 1er février 2000, Israpilov est mort lors d’une nouvelle bataille pour Grozny. Un mois plus tard, des Tchétchènes loyalistes ont livré Radouev aux fédéraux — la justice russe a condamné Salman à la perpétuité. Le 14 décembre 2002, le komsomol-terroriste est mort dans des circonstances obscures dans la tristement célèbre colonie « Cygne blanc ».

Le sort de leurs adversaires à Kizliar et Pervomaïskoïe a été moins dramatique. Mais après la crise au Daghestan, la carrière des principaux responsables de la sécurité de l’équipe d’Eltsine a décliné. En juin 1996, Barsoukov a perdu la direction du FSB. Le directeur du service spécial, en pleine campagne présidentielle, s’est mêlé aux intrigues de l’entourage d’Eltsine et a été victime du célèbre « scandale du carton Xerox ». Le chef du ministère de l’Intérieur, Koulikov, n’a pas participé aux jeux de coulisses et est resté en poste jusqu’au « défaut » de 1998, quand le ministre a dû partir avec tout le gouvernement Tchernomyrdine. Jusqu’aux années 2000, seule une figure influente est restée : l’ancien commandant en chef du groupe unifié, Viatcheslav Tikhomirov — il n’a été contraint de démissionner qu’en 2005.
Le double attentat au Daghestan a laissé à la société russe des impressions mitigées. D’un côté, il a une fois de plus révélé l’inefficacité du commandement au Caucase et mis en lumière la situation désastreuse des simples soldats et policiers. Mais à l’intérieur d’une nation où le « syndrome de Weimar » s’affirmait de plus en plus, on ne pouvait manquer de ressentir une fierté fugace de voir que l’on ne négociait plus avec les terroristes, mais qu’on tentait de les éliminer. Par coïncidence, c’est à partir de janvier 1996 que la cote de popularité d’Eltsine a commencé à remonter de façon stable. L’attitude envers le pouvoir en place s’est aussi réchauffée chez les militaires russes.
« Quoi qu’aient tenté les combattants, ils n’ont pas pu répéter Boudionnovsk. D’ailleurs, après Pervomaïskoïe, ils n’ont plus jamais osé de telles attaques à grande échelle. »
— Guennadi Troshev, général des forces armées russes, 2001
Avec le recul, l’opération à Pervomaïskoïe apparaît comme un tournant pour toute l’histoire post-soviétique de la Russie. C’est alors que, pour la première fois — timidement, presque ponctuellement —, les autorités ont construit pour les téléspectateurs une version alternative des événements, et le public l’a acceptée, non sans irritation. C’est aussi à ce moment que la direction du pays a compris une vérité aussi importante que désagréable : en situation de crise, la majorité silencieuse acceptera plus facilement la mort « collatérale » de concitoyens que de tolérer une faiblesse affichée envers l’adversaire. La fidélité des maîtres du Kremlin à cette conclusion s’est vue lors de la prise d’otages du Nord-Ost, lors de la prise d’otages de l’école de Beslan, et se voit encore aujourd’hui, alors que la guerre contre l’Ukraine approche de sa quatrième année.
Principales sources de l’article :
M. Zygar. « Tous libres : histoire de la fin des élections en Russie en 1996 » ;
E. Kaluga. « Kizliar et Pervomaïskoïe. Janvier 1996 » ;
S. Kozlov. « Spetsnaz du GRU. Cinquante ans d’histoire, vingt ans de guerre »
M. Leonov. « On aurait pu éviter la prise d’otages et tant de victimes »
Projet « Minute par minute ». « 2 000 otages »
Projet « Conseil indigène des travailleurs ». « Kizliar et Pervomaïskoïe. Comment Radouev a perdu la face deux fois »